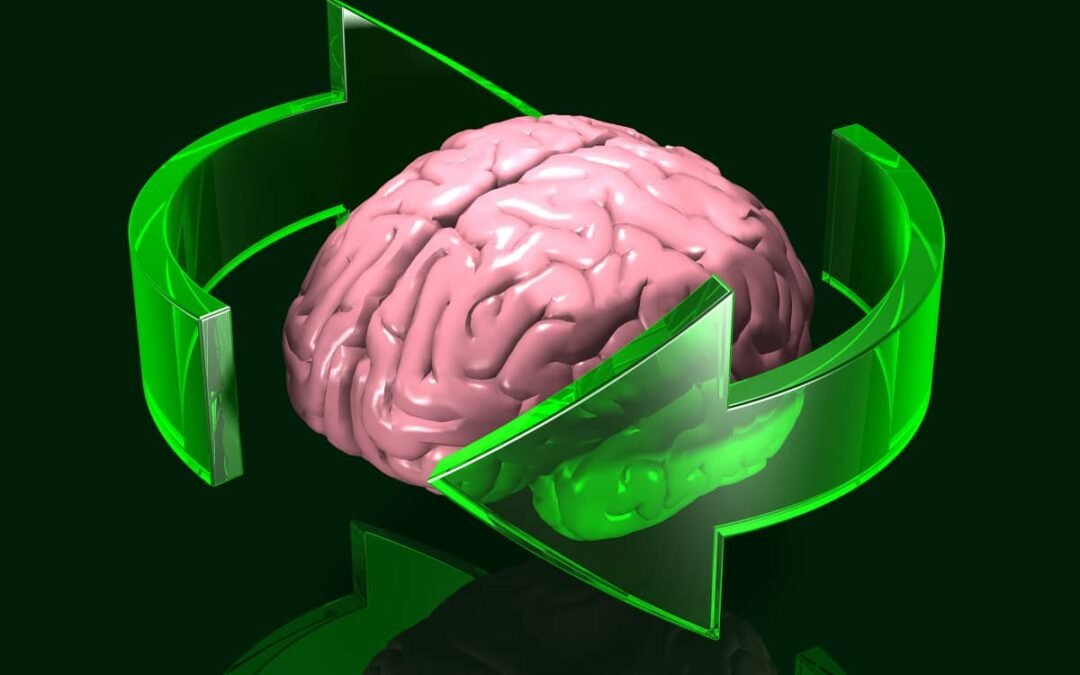Oxygénation hyperbare (OHB) pour aider après un AVC
Rappel : L’oxygénation hyperbare n’est pas un traitement pour les maladies neurologiques, mais peut être un complément aux soins médicaux permettant une amélioration de certains symptômes. Elle ne remplace pas un traitement médical !
Suite à une étude de cas récente parue en Octobre 2025 sur les effets anatomiques et métaboliques des améliorations neurologiques obtenues suite à l’oxygénation hyperbare après un AVC, j’ai voulu présenter quelques unes des études publiées à ce sujet. Les voici
L’Oxygénation hyperbare : un nouvel espoir pour les patients chroniques
L’accident vasculaire cérébral (AVC) touche chaque année des millions de personnes dans le monde, laissant souvent derrière lui des séquelles invalidantes qui peuvent persister des années. Pendant longtemps, la médecine a considéré que les possibilités de récupération étaient limitées après la phase aiguë initiale. Mais des recherches récentes remettent profondément en question cette vision, notamment grâce à l’oxygénothérapie hyperbare (OHB), une approche thérapeutique qui suscite un intérêt croissant dans le domaine de la neuroréhabilitation.
Etude de cas parue en Octobre 2025
Commençons donc par cette étude de cas publiée en Octobre 2025 L’étude de cas publiée en 2025 dans le Journal of Medical Case Reports présente le parcours exceptionnel d’un homme de 45 ans qui a retrouvé une part importante de son autonomie 15 mois après un AVC hémorragique sévère. Avant le traitement, ce patient était confiné à son fauteuil roulant, présentait une faiblesse importante du côté droit de son corps, des troubles de l’équilibre et des difficultés cognitives notables, notamment dans l’élocution, la mémoire et l’attention.
Le patient a suivi un protocole intensif d’oxygénothérapie hyperbare comprenant 83 séances réparties sur 16 semaines. Chaque séance durait 90 minutes pendant lesquelles il respirait de l’oxygène pur à une pression de 2 atmosphères absolues (2 ATA), avec de courtes pauses respirant de l’air normal pour éviter la toxicité de l’oxygène.
Le patient est passé du fauteuil roulant à la marche autonome avec une canne, sa force musculaire s’est considérablement améliorée (la force de préhension de sa main droite a plus que doublé), son équilibre s’est nettement amélioré, et ses capacités cognitives se sont restaurées. Il peut désormais parler couramment en phrases complètes, alors qu’il cherchait auparavant ses mots. Les tests neuropsychologiques ont montré une amélioration de 31% de la mémoire verbale, de 11% de la vitesse de traitement de l’information, et de 9% de l’attention.
Ce qui rend cette étude particulièrement convaincante, c’est l’utilisation de techniques d’imagerie cérébrale avancées qui ont permis de visualiser les changements dans le cerveau. L’imagerie par tenseur de diffusion (DTI) a révélé une amélioration de l’intégrité des fibres nerveuses dans plusieurs régions cruciales, avec des augmentations allant jusqu’à 33% dans certaines voies cérébrales. La tomographie par émission monophotonique (SPECT) a montré une augmentation significative de la perfusion sanguine dans les régions motrices et cognitives du cerveau, atteignant 27% d’amélioration dans certaines zones. Ces données objectives confirment que les améliorations cliniques observées correspondent à de réels changements structurels et fonctionnels dans le cerveau.
L’étude pionnière d’Efrati sur l’OHB et AVC : 74 patients avec des résultats significatifs
L’une des études les plus importantes dans ce domaine a été publiée en 2013 par le Dr Shai Efrati et son équipe en Israël. Cette étude randomisée et contrôlée a inclus 74 patients (59 ont terminé l’étude) qui avaient subi un AVC 6 à 36 mois auparavant et présentaient au moins un déficit moteur persistant.
Les patients ont été répartis en deux groupes : un groupe « traité » qui a reçu immédiatement 40 séances d’OHB, et un groupe « croisé » qui a d’abord été observé pendant 2 mois sans traitement (période contrôle), puis a ensuite reçu 40 séances d’oxygénation hyperbare (OHB). Le protocole consistait en séances quotidiennes de 90 minutes, 5 jours par semaine, avec de l’oxygène pur à 2 ATA.
Les résultats ont été remarquables : tous les patients des deux groupes ont montré des améliorations significatives de leurs fonctions neurologiques et de leur qualité de vie après les séances d’OHB, alors qu’aucune amélioration n’a été observée pendant la période contrôle du groupe croisé. Les images SPECT ont révélé une augmentation de l’activité cérébrale principalement dans les régions où il existait une discordance entre l’anatomie (structure intacte visible au scanner) et la physiologie (faible activité métabolique visible à la SPECT). Cette découverte a été cruciale : elle a démontré que l’OHB cible spécifiquement les zones cérébrales « endormies » mais non mortes, des tissus viables mais dysfonctionnels qui peuvent être réactivés.
L’étude a conclu que l’OHB peut induire une neuroplasticité significative même dans les phases chroniques tardives après un AVC, remettant en question le dogme selon lequel la récupération est limitée après les premiers mois.
Améliorations cognitives : 162 patients analysés
Une étude rétrospective publiée en 2020 par Hadanny et ses collègues a analysé les données de 162 patients victimes d’AVC qui avaient reçu entre 40 et 60 séances d’OHB. Cette étude s’est concentrée spécifiquement sur les améliorations cognitives.
Les résultats ont été impressionnants : 86% des patients ont obtenu une amélioration cliniquement significative (définie comme une amélioration de plus de 0,5 écart-type). L’OHB a induit une augmentation significative dans tous les domaines cognitifs testés, incluant les fonctions exécutives, la vitesse de traitement de l’information, la mémoire et les compétences motrices.
Un aspect particulièrement intéressant de cette étude est qu’elle n’a trouvé aucune différence significative dans les résultats entre les AVC corticaux et sous-corticaux, ni entre les AVC du côté gauche ou droit du cerveau. Toutefois, les patients ayant subi un AVC hémorragique ont montré une amélioration significativement plus importante de la vitesse de traitement de l’information par rapport aux AVC ischémiques. Ces résultats suggèrent que la sélection des patients pour l’OHB devrait se baser sur l’analyse fonctionnelle et les scores cognitifs de base plutôt que sur le type, la localisation ou le côté de la lésion.
Récupération motrice de la main : les apports de l’IRM fonctionnelle
Une étude de cas publiée en 2023 par Catalogna et ses collègues a utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour étudier les mécanismes neurologiques sous-jacents à la récupération motrice de la main après oxygénation hyperbare (OHB) chez un patient chronique post-AVC souffrant d’une déficience motrice sévère du membre supérieur.
Cette étude a utilisé à la fois l’IRMf basée sur des tâches spécifiques et l’IRMf au repos pour analyser les réponses neurales et la réorganisation fonctionnelle. Les résultats ont montré que l’OHB (2 ATA) induit des modifications dans la connectivité cérébrale et l’activation des régions motrices, contribuant à l’amélioration de la fonction de la main. Cette étude a apporté des preuves importantes sur les mécanismes par lesquels l’OHB favorise la récupération motrice, démontrant une réorganisation fonctionnelle du cerveau même des années après la lésion initiale.
Faisabilité en pratique clinique : l’étude suisse sur l’OHB et l’AVC
Une étude de faisabilité publiée en 2023 par des chercheurs suisses a évalué la possibilité d’intégrer l’oxygénation hyperbare (OHB) dans la pratique clinique quotidienne pour des patients post-AVC non sélectionnés présentant des symptômes résiduels légers à modérés. Cette étude prospective a inclus des patients qui avaient terminé leur programme standard de réhabilitation en milieu hospitalier et qui étaient capables de se déplacer quotidiennement vers le centre de traitement, avec des distances de déplacement allant jusqu’à 110 kilomètres.
L’étude visait à inclure 10 participants capables de compléter 40 séances quotidiennes d’OHB à 2 ATA. L’efficacité a été évaluée à l’aide du score NIHSS (National Institutes of Health Stroke Score) avant et après l’OHB. À l’exception de deux patients dont l’état neurologique est resté inchangé, tous les autres patients ont connu une amélioration de leur fonction neurologique après l’OHB, telle que mesurée par le NIHSS.
Les chercheurs ont été satisfaits du taux relativement élevé de réponses positives à l’OHB, même sans avoir sélectionné les patients sur la base d’informations d’imagerie avancée concernant leur potentiel de neuroplasticité. Cette étude démontre qu’il est pratiquement faisable d’offrir l’OHB aux patients post-AVC dans un cadre clinique réel, même lorsque ceux-ci doivent parcourir de longues distances. Cependant, l’étude a également identifié certains effets secondaires visuels temporaires (comme une myopie transitoire), qui sont connus et généralement réversibles après l’arrêt du traitement.
Les résultats plus nuancés : la méta-analyse de 2024
Il est important de présenter également les résultats plus mitigés de certaines études. Une méta-analyse systématique publiée en 2024 par Li et ses collègues a évalué l’efficacité et la sécurité de l’OHB en tant que thérapie adjuvante dans l’AVC ischémique aigu. Cette revue a analysé 8 études incluant 493 patients.
Les résultats de cette méta-analyse n’ont montré aucune différence statistiquement significative entre l’OHB et le groupe contrôle en termes de score NIHSS, d’indice de Barthel (mesure de l’autonomie fonctionnelle), ou de marqueurs inflammatoires. Cependant, il est crucial de noter que cette méta-analyse se concentrait sur l’AVC aigu, et non sur les phases chroniques, et que la plupart des études incluses utilisaient des protocoles très courts (certaines avec une seule séance d’OHB), ce qui contraste fortement avec les protocoles plus intensifs (40 à 80 séances) utilisés dans les études montrant des bénéfices en phase chronique.
Cette différence soulève une question importante : le moment d’administration et la durée du traitement sont probablement des facteurs critiques. L’OHB pourrait être plus efficace en phase chronique, lorsque les processus inflammatoires aigus se sont calmés et que le cerveau est dans une phase de régénération, plutôt qu’en phase aiguë où l’administration précoce pourrait même potentiellement aggraver certains processus dommageables.
Essai contrôlé randomisé récent sur les lésions cérébrales
Une étude randomisée en double aveugle publiée en 2025 par Weaver et ses collègues a examiné l’effet de l’oxygénation hyperbare (OHB) sur les symptômes persistants après une lésion cérébrale non-AVC (principalement des traumatismes crâniens). Les 47 participants ont reçu soit 40 séances d’OHB, soit 40 séances factices sur 12 semaines.
Le critère d’évaluation principal était le score de l’Inventaire des Symptômes Neurocomportementaux (NSI) à 13 semaines. Les résultats ont montré une amélioration significativement plus importante dans le groupe OHB par rapport au groupe placebo.
Bien que cette étude porte sur les traumatismes crâniens plutôt que sur les AVC, elle fournit des preuves supplémentaires que l’OHB peut favoriser la récupération neurologique dans les phases chroniques des lésions cérébrales, renforçant l’hypothèse d’un effet neuroplastique.
Oxygénothérapie à 2 bars de pression ou oxygénation hyperbare à 1,5 bars de pression ?
Il est important de noter que la dernière étude était à 1,5 bar de pression (1,5 ATA); comme utilisé dans notre centre; tandis que les autres études étaient dans un caisson à 2 ATA; utilisé dans les hôpitaux sous supervision médicale et avec de l’oxygène pure.
Alors quelle différence et est-ce que cela a une incidence ?
C’est un sujet de discussion mais il existe effectivement des études concrètes qui montrent les avantages de l’OHB à 1,5 bar de pression et qui sont sans les effets secondaires qu’on peut rencontrer dans les OHB à 2 bars de pression et au-delà.
Les études à 1,5 ATA
Plusieurs essais cliniques ont utilisé des pressions modestes de 1,5 ATA pour traiter l’AVC ischémique aigu, notamment les études d’Anderson (1991), Nighoghossian (1995) et Sansone (1997). Ces études impliquaient généralement des traitements quotidiens pendant 10 jours à 1,5-1,8 ATA, avec des séances de 60 minutes.
Traumatismes crâniens
Des essais contrôlés randomisés ont démontré l’efficacité de l’OHB à 1,5 ATA pour les traumatismes crâniens, même lorsqu’elle est administrée des années après la lésion. Le Dr Harch a démontré des améliorations constantes de l’imagerie SPECT du cerveau (montrant une amélioration du flux sanguin cérébral) chez des patients atteints de traumatismes crâniens chroniques traités avec l’OHB à 1,5 ATA.
Une étude randomisée en double aveugle publiée en 2025 par Weaver a utilisé 1,5 ATA pour traiter des symptômes persistants après lésion cérébrale (principalement des traumatismes crâniens). Les 47 participants ont reçu soit 40 séances d’OHB à 1,5 ATA, soit 40 séances factices. Les résultats ont montré une amélioration significativement plus importante dans le groupe OHB avec une différence moyenne de 7,0 points sur l’Inventaire des Symptômes Neurocomportementaux.
AVC hémorragique : comparaison 2,5 ATA vs 1,5 ATA
Une étude prospective randomisée contrôlée a comparé 79 patients diabétiques souffrant d’hémorragie intracérébrale aiguë : un groupe recevait de l’oxygène pur à 2,5 ATA pendant 60 minutes (HyperBOT), l’autre à 1,5 ATA (NormBOT) utilisé comme contrôle. Aucune différence distincte n’a été observée entre les groupes lors du suivi à un mois. Cependant, lors du suivi à long terme de six mois, une fréquence plus élevée de patients dans le groupe HyperBOT (2,5 ATA) a obtenu de bons résultats avec des conséquences neurologiques relativement élevées par rapport au groupe NormBOT (1,5 ATA).
Le concept des tissus dysfonctionnels non nécrosés
L’un des concepts les plus importants pour comprendre l’efficacité de l’OHB est celui des « tissus dysfonctionnels non nécrosés ». Après un AVC, le cerveau contient des zones qui ne sont pas mortes (nécrosées) mais qui fonctionnent mal en raison d’un métabolisme perturbé et d’une mauvaise perfusion sanguine. Ces régions sont souvent appelées « pénombre ischémique chronique » ou « tissus en veille ».
Ces zones peuvent être identifiées en combinant l’imagerie anatomique (IRM ou scanner) avec l’imagerie fonctionnelle (SPECT ou TEP). Lorsqu’il existe une discordance entre les déficits de perfusion visibles à l’imagerie fonctionnelle et l’anatomie relativement intacte visible à l’imagerie structurelle, cela indique la présence de tissus cérébraux viables qui peuvent potentiellement répondre à l’OHB.
C’est précisément dans ces régions que l’OHB exerce ses effets bénéfiques. En améliorant l’apport en oxygène, en stimulant la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et en activant les mécanismes de neuroplasticité, l’OHB permet à ces régions « endormies » de se réveiller progressivement et de reprendre leurs fonctions. Cette découverte explique pourquoi certains patients peuvent bénéficier de l’OHB même des années après leur AVC initial : tant qu’il existe des tissus viables mais dysfonctionnels, il reste un potentiel de récupération.
Protocoles de traitement d’oxygénation hyperbare : la durée compte
Les études montrant les résultats les plus positifs utilisent généralement des protocoles intensifs comprenant au minimum 40 séances, et jusqu’à 60-83 séances pour les cas plus sévères. Les séances sont administrées quotidiennement, 5 jours par semaine, chaque séance durant entre 60 et 90 minutes.
Cette durée prolongée semble cruciale pour induire une neuroplasticité significative et une angiogenèse durable. Les études utilisant seulement une ou quelques séances d’OHB n’ont généralement pas montré de bénéfices, suggérant que les effets cumulatifs et répétés sont nécessaires pour déclencher les mécanismes de réparation à long terme.
Sécurité et effets secondaires
L’OHB est généralement considérée comme sûre lorsqu’elle est administrée correctement dans des installations certifiées. Les effets secondaires les plus courants sont temporaires et incluent :
– Barotraumatisme de l’oreille (problèmes d’égalisation de la pression dans les oreilles)
– Myopie transitoire (changements temporaires de la vision qui se résolvent généralement dans les semaines suivant l’arrêt du traitement)
– Inconfort ou claustrophobie dans la chambre hyperbare
– Fatigue temporaire après les séances
Applications émergentes et recherches futures sur l’OHB
Au-delà de l’AVC, l’OHB fait l’objet de recherches pour d’autres conditions neurologiques, notamment les traumatismes crâniens, le syndrome post-commotionnel persistant, le trouble de stress post-traumatique, les symptômes post-COVID-19, la fibromyalgie associée à des antécédents de traumatisme, et les troubles cognitifs liés au vieillissement.
Une analyse bibliométrique publiée en 2025 a identifié les tendances de recherche sur l’OHB et l’AVC entre 2000 et 2022. Cette analyse a révélé que les États-Unis dominent la recherche dans ce domaine, que le Dr Shai Efrati est l’auteur le plus prolifique, et que la fonction cognitive est devenue le principal axe de recherche dans les applications de l’OHB pour l’AVC. Le nombre de publications fluctue d’une année à l’autre, mais l’intérêt scientifique reste soutenu.
Implications cliniques et recommandations
Sur la base des preuves actuelles, plusieurs implications cliniques émergent :
- L’OHB devrait être envisagée chez les patients présentant des déficits neurologiques persistants qui ont atteint un plateau avec les thérapies conventionnelles.
- Les preuves suggèrent que l’OHB est plus efficace en phase chronique (au-delà de 6 mois après l’AVC) plutôt qu’en phase aiguë. En phase chronique, les processus inflammatoires aigus se sont calmés et le cerveau entre dans une phase de régénération plus propice à la neuroplasticité induite par l’OHB.
- Un minimum de 40 séances semble nécessaire, avec jusqu’à 60-80 séances recommandées pour les cas plus sévères. Les protocoles courts (une ou quelques séances) se sont révélés inefficaces.
- L’OHB ne devrait pas être utilisée seule, mais intégrée dans un programme complet de neuroréhabilitation incluant physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, et soutien psychologique.
Conclusion : un espoir réel mais des preuves à consolider
L’oxygénothérapie hyperbare représente une approche prometteuse pour améliorer la récupération des patients victimes d’AVC chronique. Les preuves scientifiques actuelles, bien que nécessitant encore d’être consolidées par des essais de plus grande envergure, suggèrent que l’OHB peut induire une neuroplasticité significative même des années après l’événement initial, remettant en question le paradigme traditionnel selon lequel la récupération est limitée aux premiers mois.
Les mécanismes d’action sont bien compris sur le plan biologique : l’OHB stimule l’angiogenèse, la neuroplasticité, la prolifération de cellules souches, et la restauration de la fonction mitochondriale. Les techniques d’imagerie avancées comme le DTI et la SPECT permettent de visualiser ces changements et pourraient à l’avenir aider à identifier les patients les plus susceptibles de bénéficier du traitement.
Cependant, l’OHB n’est pas une solution miracle. Elle fonctionne mieux lorsqu’elle est intégrée dans un programme complet de réhabilitation, avec des protocoles intensifs (minimum 40 séances), et probablement chez des patients soigneusement sélectionnés présentant des tissus cérébraux dysfonctionnels mais viables. Les résultats varient considérablement d’un individu à l’autre, et certaines études récentes n’ont pas confirmé les bénéfices observés dans les travaux précédents.
Pour les millions de personnes vivant avec les séquelles d’un AVC, ces recherches apportent néanmoins un message d’espoir important : le cerveau conserve une remarquable capacité de réparation et de réorganisation, même dans sa phase chronique. L’OHB pourrait représenter une nouvelle frontière dans le traitement des lésions cérébrales, transformant ce qui était autrefois considéré comme des déficits permanents en opportunités de récupération.
—
Références :
- Efrati S, Fishlev G, Bechor Y, et al. (2013). Hyperbaric oxygen induces late neuroplasticity in post stroke patients—randomized, prospective trial. PLoS ONE, 8(1): e53716
- Hadanny A, Efrati S, Bechor Y, et al. (2020). Hyperbaric oxygen therapy improves neurocognitive functions of post-stroke patients—a retrospective analysis. Restorative Neurology and Neuroscience, 38(1): 93-107
- Boussi-Gross R, Golan H, Volkov O, et al. (2015). Improvement of memory impairments in poststroke patients by hyperbaric oxygen therapy. Neuropsychology, 29(4): 610-621
- Catalogna M, Hadanny A, Parag Y, et al. (2023). Functional MRI evaluation of hyperbaric oxygen therapy effect on hand motor recovery in a chronic post-stroke patient: a case report and physiological discussion. Frontiers in Neurology, 14: 1233841
- Li X, Lu L, Min Y, et al. (2024). Efficacy and safety of hyperbaric oxygen therapy in acute ischaemic stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurology, 24(1): 55
- Étude de faisabilité suisse (2023). Hyperbaric Oxygen in Post-Stroke Patients: A Feasibility Study. MDPI, 7(4): 41
- Weaver LK, et al. (2025). A double-blind randomized trial of hyperbaric oxygen for persistent symptoms after brain injury. Scientific Reports, 15(1): 6885
- Harrison et al. (2024). Hyperbaric Oxygen Post Established Stroke [étude randomisée contrôlée sur l’AVC chronique]
- Bin-Alamer O, Abou-Al-Shaar H, Efrati S, et al. (2024). Hyperbaric oxygen therapy as a neuromodulatory technique: a review of the recent evidence. Frontiers in Neurology, 15: 1450134
- Zhou, Chen, Li, et al. (2025). Bibliometric analysis of research trends on hyperbaric oxygen therapy in stroke from 2000 to 2022. Article publié avec analyse des 323 publications identifiées
- Gonzales-Portillo B, Lippert T, Nguyen H, et al. (2019). Hyperbaric oxygen therapy: a new look on treating stroke and traumatic brain injury. Brain Circulation, 5(3): 101-105
- Anderson DC, Bottini AG, Jagiella WM, et al. (1991). A pilot study of hyperbaric oxygen in the treatment of human stroke. Stroke, 22(9): 1137-114
- Nighoghossian N, Trouillas P, Adeleine P, Salord F. (1995). Hyperbaric oxygen in the treatment of acute ischemic stroke: a double-blind pilot study. Stroke, 26(8): 1369-1372
- Sansone GR, Guglielmetti C, Stojanovic A, et al. (1997). Treatment of acute ischemic stroke with hyperbaric oxygen: basic mechanisms and clinical experience. Journal of Hyperbaric Medicine, 12(1): 23-31
- Holbach KH, Wassmann H, Kolberg T. (1977). Improved reversibility of the traumatic cerebral edema by administration of hyperbaric oxygen (author’s transl). Acta Neurochirurgica, 37(1-2): 124-138
- Harch PG, Andrews SR, Fogarty EF, et al. (2012). A phase I study of low-pressure hyperbaric oxygen therapy for blast-induced post-concussion syndrome and post-traumatic stress disorder. Journal of Neurotrauma, 29(1): 168-185
- Harch PG, Fogarty EF, Staab PK, Van Meter K. (2009). Low pressure hyperbaric oxygen therapy and SPECT brain imaging in the treatment of blast-induced chronic traumatic brain injury (post-concussion syndrome) and post traumatic stress disorder: a case report. Cases Journal, 2: 6538
- Hu Q, Liang X, Chen D, et al. (2016). Delayed hyperbaric oxygen therapy promotes neurogenesis through reactive oxygen species/hypoxia-inducible factor-1α/β-catenin pathway in middle cerebral artery occlusion rats. Stroke, 47(5): 1399-1405
- Étude prospective sur l’hémorragie intracérébrale (auteurs et référence exacte à vérifier – l’étude comparant 2,5 ATA vs 1,5 ATA chez 79 patients diabétiques)
- Bennett MH, Wasiak J, Schnabel A, et al. (2005). Hyperbaric oxygen therapy for acute ischaemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3): CD004954
- Shi XY, Tang ZQ, Sun D, He XJ. (2006). Evaluation of hyperbaric oxygen treatment of neurological disorders following different schedules: a topical review. Neurological Research, 28(1): 112-123
- Kendall AC, Whatmore JL, Harries LW, et al. (2012). Changes in inflammatory gene expression induced by hyperbaric oxygen treatment in human endothelial cells under chronic wound conditions. Experimental Cell Research, 318(3): 207-216
- Thom SR. (2009). Oxidative stress is fundamental to hyperbaric oxygen therapy. Journal of Applied Physiology, 106(3): 988-995
- Matchett GA, Martin RD, Zhang JH. (2009). Hyperbaric oxygen therapy and cerebral ischemia: neuroprotective mechanisms. Neurological Research, 31(2): 114-121.
NDLR : Dans notre cabinet, l’oxygénation hyperbare se fait à une pression de 1,3 ou 1,5 bar de pression et en combinaison des soins appropriés pour les troubles de stress post-traumatiques tels que la photobiomodulation ou laser froid, la neuro-stimulation et des soins chiropratiques combinés à la neurologie fonctionnelle.